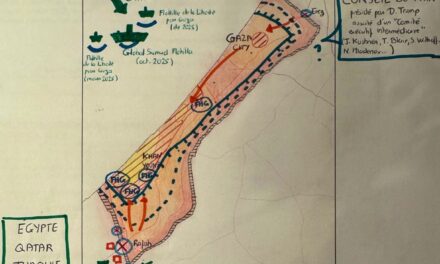La « trève » du 25 décembre
La date avait-elle été choisie au hasard ? Le calendrier orthodoxe fixant Noël au début du mois de janvier, était-ce sinon un « cadeau » adressé aux Occidentaux, du moins une main tendue ? Le 25 décembre dernier, Vladimir Poutine semblait en effet entrouvrir une porte en se disant « prêt à négocier avec tous les participants » au conflit. Dans le même temps, il continuait de souffler le chaud et le froid en fustigeant des Occidentaux refusant tout « pourparler », le tout sur fond d’alliance militaire renforcée avec la Biélorussie et d’exercices militaires conjoints avec la Chine.
Gagner du temps
Plus qu’une perspective de paix immédiate, il fallait sans doute d’abord lire dans l’évocation de négociations éventuelles un moyen pour le Kremlin de gagner du temps et de ménager une image déjà dégradée, auprès de ses alliés comme de son opinion publique. C’était aussi le signe que la fatigue de la guerre s’installait, dix mois presque jour pour jour après le lancement de « l’opération militaire spéciale » le 24 février 2022. Une fatigue partagée car, dans nos démocraties, le soutien à l’Ukraine représente un poids économique certain, même si un hiver pour l’instant peu rigoureux l’allège. Chaque décision est précédée de querelles byzantines péniblement surmontées. Côté russe, les paramilitaires stipendiés par le groupe Wagner sont, depuis plusieurs mois maintenant, recrutés… dans les prisons.
Le « brouillard de la guerre » rend difficiles à lire les avancées et les reculs sur le terrain. Tout pronostic est hasardeux, mais les objectifs et la feuille de route de chacun ne sont pas non plus clairement – et encore moins officiellement – établis. Le rapport de force, malgré l’usure qu’il génère, ne semble pas augurer d’une prise de conscience sur la nécessité de négocier.
Un conflit dans l’impasse
Pour l’instant, c’est donc le bras de fer qui continue ; Russes comme Ukrainiens tentent très classiquement de renforcer leur position. Les premiers poursuivent donc leurs bombardements sur les infrastructures vitales, les autres s’apprêtent à recevoir une nouvelle enveloppe d’aides, des batteries de missiles Patriot et, désormais, des chars lourds. Vladimir Poutine, quant à lui, a bien appelé de ses vœux un cessez-le-feu début janvier. Mais c’était un gage à destination de l’Église orthodoxe, aussi arc-boutée que le Kremlin sur le concept de « Russie historique ». Moscou demeure donc inflexible quant au statut des territoires russophones en Crimée et dans le Donbass.
L’impasse judiciaire
Mettre un terme aux hostilités, d’une quelconque manière, se heurterait aussi à la question judiciaire posée depuis plusieurs mois. Des procédures ont déjà été engagées concernant des actes de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocideL’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) et l’article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) entendent par génocide « l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe ; atteinte à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. ». A priori, nombre d’exactions rapportées et déjà documentées semblent rentrer dans le cadre défini par les Nations Unies pour le crime de génocide1. Des éléments matériels ont été collectés à foison dans ce sens. Mais ce processus sera extrêmement long et compliqué à mettre en œuvre. Le Statut de Rome et la Cour pénale internationale (CPI) qui s’y appuie ne sont pas pleinement reconnus par la Russie (qui pèsera de tout son poids diplomatique, notamment à l’ONU, pour entraver toute action qui lui serait préjudiciable) ou par la Chine (allié indéfectible de Moscou). Cette dernière joue et continuera de jouer à l’excès la temporisation, par crainte d’un dangereux précédent quant à la question du traitement des Ouïghours.
Vous souhaitez lire la suite ?
Actifs dans le débat public sur l'enseignement de nos disciplines et de nos pratiques pédagogiques, nous cherchons à proposer des services multiples, à commencer par une maintenance professionnelle de nos sites. Votre cotisation est là pour nous permettre de fonctionner et nous vous en remercions.